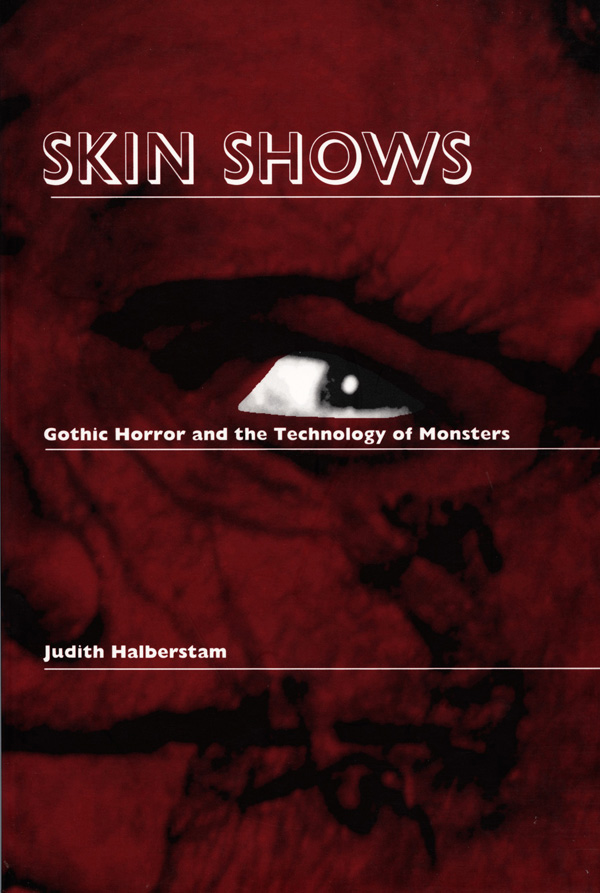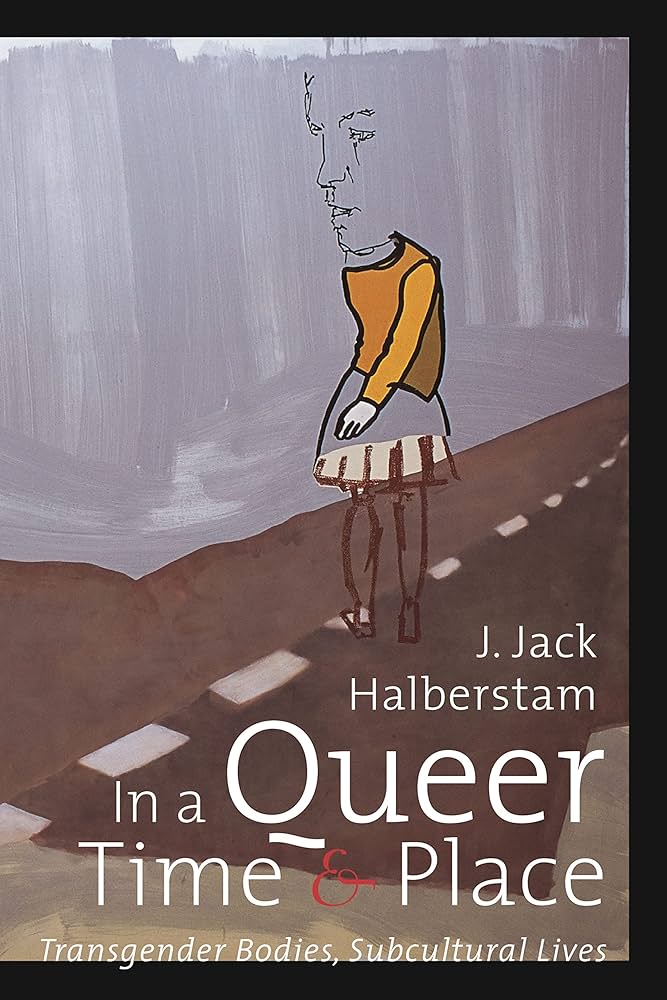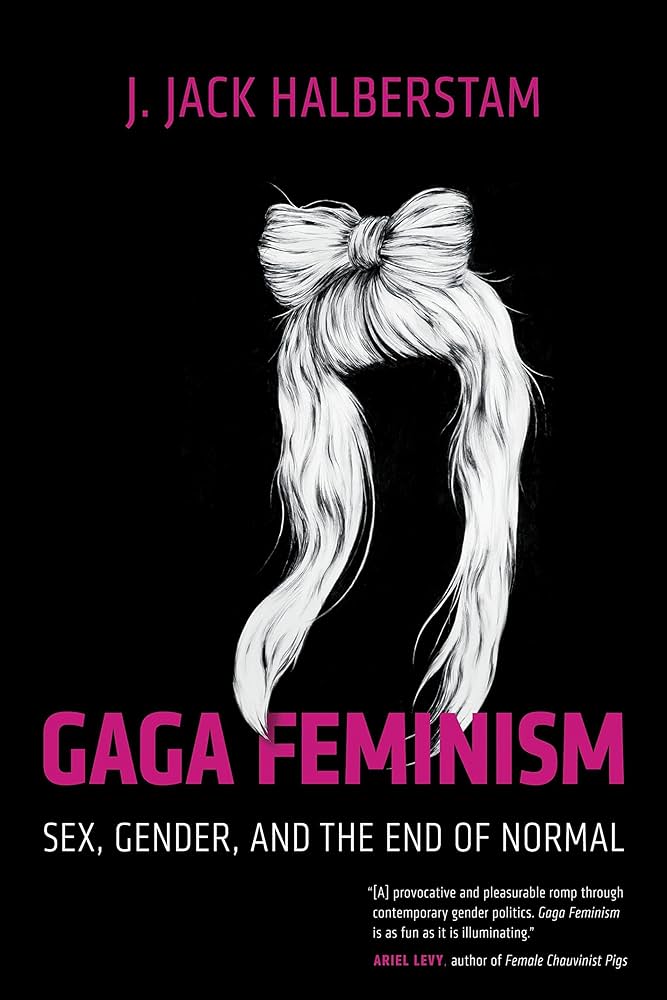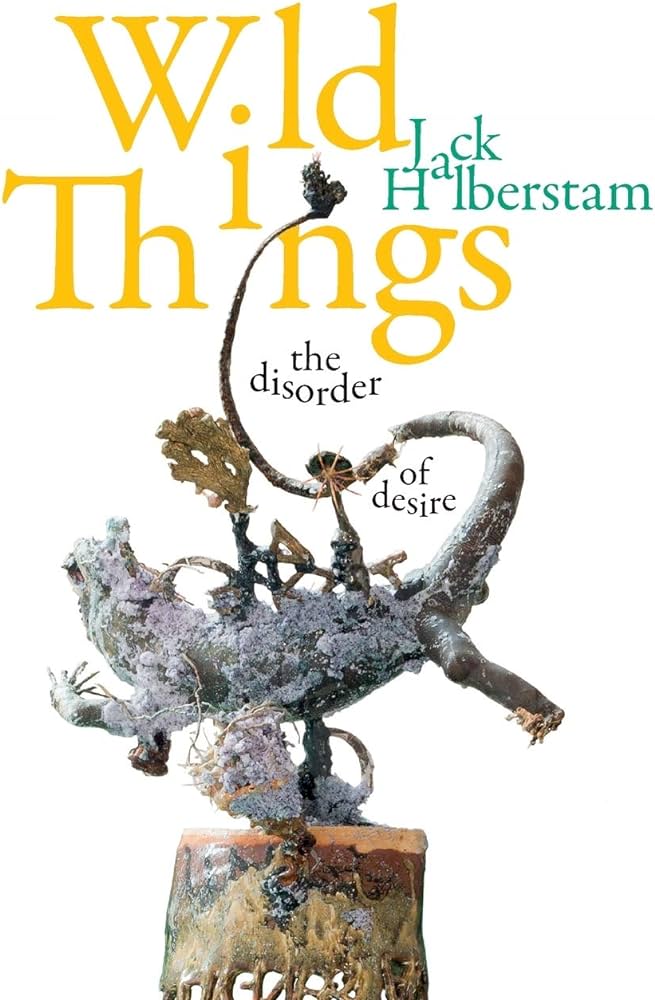Zine :
Lien original : via Trou Noir
En anglais :
Début octobre, Jack Halberstam était à Paris pourle lancement de son premier livre traduit en français, Trans*. Brève histoire de la variabilité de genre, aux éditions Libertalia. À cette occasion, un petit groupe de théoricien‧nes et d’étudianz en études queer et trans* s’est réuni pour discuter avec lui des histoires et des politiques coalitionnelles auxquelles il appelle dans son livre et dans son œuvre.
Trou Noir remercie l’ensemble des traducteur‧ices et intervenant‧es et Béton Salon pour l’accueil.
Clovis Maillet : Tu dis au début de ton livre que ton but c’est d’expliquer “comment on en est venux à être trans*”, et comment avoir un nom pour se dire peut causer autant de dommages que de ne pas en avoir. Le livre propose une histoire de la terminologie et des combats pour les droits, et pour les manières de se nommer. Est-ce que, dans ce contexte, tu pourrais nous parler du dialogue entre les générations qui n’avaient pas les mêmes terminologies pour se dire, ni les mêmes luttes ?
Jack Halberstam : Alors oui, je crois que j’ai écrit ce livre pour essayer d’expliquer certains des paradigmes antérieurs aux nouvelles générations qui se sentaient déconnectées de leurs aînéEs ; qui avaient quant à elleux commencé à se dire trans dans un contexte tout à fait différent. Ce que je me suis dit, c’est : et si j’expliquais ce que ça impliquait que d’essayer de se comprendre en tant que trans quand tu n’as pas accès à YouTube, quand personne n’est là pour te proposer des hormones, quand tu ne peux même pas l’expliquer à tes parents, et que donc tu ne te poses pas les mêmes sortes de questions.
Mais comme tu le dis, d’un autre côté, le livre dit aussi : souvenons-nous qu’avoir un langage pour une chose, ça peut poser problème. Ce n’est pas seulement bénéfique d’avoir des noms comme trans ou non-binaire. Ces terminologies peuvent aussi être utilisées par l’État pour te gérer, te contrôler, te retrouver, t’administrer, te censurer, t’empêcher. Ce que je veux dire, c’est que la visibilité, le projet de visibilité et de lisibilité, ne fait pas tout. Et de fait, pendant les premières décennies de la théorie queer, toute la question était de savoir si l’on était obligéz de participer à cette structure de légitimation qui repose sur l’adoption, dans une inversion discursive, du langage qui t’a été assigné. Et tu sais, c’est ce que Foucault explique de manière si monumentale dans son Histoire de la sexualité : ces classifications proviennent d’un ordre colonial et ne commencent ensuite à fonctionner que quand les communautés auxquelles elles s’adressent les adoptent. Et donc, adopter les catégories peut avoir un effet à double tranchant. D’un côté, tu as un nom, de l’autre côté, on t’a donné un nom et tu l’as accepté. Et ce n’est pas toujours une raison de se réjouir. Ça, c’était une première trajectoire du livre.
Et ensuite, l’autre trajectoire était de dire aux nouvelles générations : quand vous dénoncez les films réalisés par les générations antérieures, et quand vous lisez des textes qui ont été publiés il y a 20 ans, et que vous les dénoncez, vous choisissez le mauvais combat. La lutte n’est pas là. Notre lutte est contre le capitalisme autoritaire, contre sa manière de gérer les corps, les minorités sexuelles, et les populations de genres déviants. Et nous avons besoin de solidarité entre les générations, et entre tous les types de différence, peu importe lesquelles.
Léo love Gentil : En lien avec ce que tu es en train de dire, j’avais une question sur les monstres. Tu as commencé à travailler sur les freaks, n’est-ce pas, dans ton premier livre Skin Shows. Et donc, depuis le début, tu as un intérêt pour les monstres, et je me demandais comment cela a affecté ton travail ultérieur sur queer et sur trans*. Plus spécifiquement, je vois deux sites dans trans* : d’un côté, il y a des personnes qui se reconnaissent dans le mot trans* d’une manière qui leur permet de transitionner et d’entrer dans un genre “final” (quel qu’il soit) ; et de l’autre, il y a des personnes qui refusent de quitter la catégorie trans* et cela peut aller de butch, à monstre, à alien, et à autant de genres que l’astérisque peut accueillir. Et donc ma question n’est très claire mais je me demande : comment est-il possible que trans* soit capable d’accueillir tout cela ? Et qu’est-ce qu’on peut en faire ?
Jack Halberstam : Ok, alors allons-y progressivement parce c’est une super question. J’apprécie le lien que tu fais avec ces interrogations antérieures qui sont effectivement bien présentes dans le livre. Mon argument général sur les monstres, ce n’est pas qu’ils sont mauvais, c’est plutôt que tout ce qui est considéré comme monstrueux par une culture appartient probablement à un espace de transgression de ladite culture. C’est du moins le cas au 19e siècle où l’accent était mis sur la production de valeurs normatives et d’un idéal de la subjectivité qui en général avait des dimensions raciales. Dans ce contexte, læ monstre sert de moyen de défense pour la blanchité, pour l’hétérosexualité, etc. ; c’est une sorte d’entité hybride constituée de tous les morceaux de ce que la société cherche à désavouer. C’est ainsi que læ monstre est souvent racialisé‧e comme dans Frankenstein et surtout dans Dracula, où les vampires viennent d’ailleurs, sont synonymes de l’étranger, de l’immigrant. Les vampires sont vu‧es comme parasites, iels veulent sucer le sang de la nation. Et même, iels sont vu comme des créatures qui veulent voler les femmes blanches. C’est pour cela que le discours sur la monstruosité aux XIXème siècle est aussi fascinant : en raison de ce qu’il nous dit de l’altérité et de l’histoire de l’altérité.
Et donc quand on est plongé dans cette logique comme je le suis, c’est difficile de souhaiter une identité trans normative. N’attendez pas de moi que je dise : mais enfin, nous sommes comme tout le monde. Au contraire, je vais être du côté de celleux qui disent : vous croyez que nous sommes des monstres ? Mais nous sommes des monstres ! Et entendez-nous bien : nous sommes des monstres qui ne cherchons pas à nous normaliser ; nous cherchons la différence et nous voulons que cette différence ait du sens. Mais plus encore : nous cherchons à faire en sorte que cette différence détruise le système qui fait de nous des monstres.
Voilà la trajectoire qui m’intéresse, et c’est une trajectoire abolitionniste, qui consiste à contre-attaquer la critique qui est faite contre toi, pas pour en finir avec son discours, mais pour en finir avec la société qui a produit ce discours, qui le fait apparaître comme quelque chose de raisonnable. Une société qui est capable d’inclure la transphobie est une société absurde ; donc ce n’est pas suffisant de nous en prendre à la transphobie ; il nous faut démanteler la société entière où la transphobie a réussi à naître. Et je ne suis pas certain d’arriver à dire cela autant que je le voudrais dans Trans*, parce que, bon, voilà je ne suis pas un économiste, donc pour tenter de rendre compte de ces idées sans en passer par des théories de la gouvernance ou de l’économie politique, je dois utiliser mes savoir-faire particuliers, qui viennent des études queer et la culture pop, de la littérature et du cinéma.
Emma Bigé : Il y a quelque chose que j’apprécie dans ton travail en général et dans Trans* en particulier et c’est l’image très particulière que tu y donnes de ce qu’une communauté queer pourrait être. Et je comprends ce mot de communauté d’une manière assez spécifique : pas une communauté qui serait définie par un descripteur commun censé nous réunir, et qui pourrait être par exemple la forme non-normative que prennent nos désirs ou nos sexualités, – c’est souvent comme ça qu’on pense à queer – mais plutôt une communauté au sens où nous avons des communs, c’est-à-dire des choses ou des pratiques ou des idées dont nous prenons soin ensemble. Alors généralement, les communs ce sont des biens comme l’eau, ou la forêt, ou la terre d’un territoire donné, mais comment penser cela quand on a une communauté transnationale et même transtemporelle ? Hé bien je crois que justement ton travail donne beaucoup d’éléments pour penser cela, de In A Queer Time & Place à The Queer Art of Failure, où tu décris la façon dont les vies queers ont inventé des manières uniques d’habiter le temps et l’espace, ou de refuser de parvenir et d’embrasser l’échec : des manières qui font un peu partie de ces communs dont nous prenons soin ensemble et qui nous réunissent par le fait que nous en prenons soin ensemble. Et donc, ma question ce serait : est-ce que tu crois qu’on peut parler et penser dans le même sens des communs trans* ? Ou pour le dire autrement : de quoi on prend soin quand on prend soin de cette communauté ? Et comment ce soin est au service de la politique dont tu parlais à l’instant ?
Jack Halberstam : Oh c’est vraiment, vraiment une belle question que tu me poses là. Merci. Je crois que je n’ai jamais utilisé ce concept de communs trans* mais je peux très bien m’imaginer l’employer au sens où tu l’emploies, c’est-à-dire au sens de communs qui ne sont pas seulement l’espace où nous nous retrouvons et où nous vivons ensemble, mais une certaine sorte d’attention que nous nous prêtons les unes aux autres, un soin que nous acceptons de nous donner les unes aux autres, un lien que nous sommes prêt‧es à soutenir malgré nos différences. Et je crois en effet que je suis très engagé dans la défense des communs trans* en ce sens-là, oui, mais je sens aussi que de plus en plus, ce qui m’intéresse c’est comment ces communs sont susceptibles de se lier à tous les autres communs qui peuvent bénéficier de la remise en cause du status quo où nous vivons. En ce sens, je crois que le concept de sous-communs est ce à quoi je veux rapporter les communs trans*, au sens où ce que je veux, c’est un espace sous-commun le plus vaste possible, un espace qui rendra les communs trans* possibles mais aussi bien avec eux d’autres communs, tu vois ce que je veux dire ?
Emma Bigé : Tu finis d’ailleurs Trans* sur une phrase de ce livre auquel tu fais allusion, Les sous-communs de Fred Moten et Stefano Harney, phrase que tu avais d’ailleurs déjà relevée dans ta préface à leur livre : “Je n’ai pas besoin de ton aide. J’ai juste besoin que tu comprennes que cette merde te tue toi aussi, bien que plus doucement, tu captes, espèce d’enfoiré*e ?”
Jack Halberstam : Oui, j’hérite beaucoup de Fred et de Stefano en termes de manières de penser, et en particulier dans leur stratégie qui consiste à ne jamais vraiment dire qui sont les sous-communs, au juste. Tout ce qu’ils disent c’est : si tu es là et que tu es en train de lire ce livre et que tu te sens en sympathie avec ce qui s’y dit, alors tu en fais déjà partie. Et c’est ce que j’essaye de dire dans l’introduction que j’ai faite à leur livre. Tu n’as pas besoin de demander : au fait, comment est-ce que je rejoins votre groupe ? Où est-ce que je vous trouve ? Tu en fais déjà partie. Tu en fais déjà partie parce que tu es là, tu lis, tu participes, et voilà, c’est cela le genre de commun auquel j’aspire.
Et puis d’un autre côté, et ça c’est vraiment la leçon que j’apprends auprès de Fred Moten en particulier, c’est l’insistance à nous sortir des luttes intestines du genre de celles où les queers ou les féministes se retrouvent à être pointées du doigt pour l’exclusion des trans. Et c’est ce que j’essayais de dire tout à l’heure quand je disais que ce que nous devons comprendre, c’est que c’est la structure sociale dans laquelle nous vivons qui génère ces luttes intestines et qui nous les présente comme si elles étaient les bonnes luttes à mener, d’une manière qui obscurcit ce qui devrait être le véritable objet de notre lutte à savoir : le capitalisme, ou le fascisme qui est en train de réapparaître à l’extrême-droite. Et les femmes transphobes, qui sont des bénéficiaires de ces régimes, et qui ne sont pas des féministes (mais qui assurément sont transphobes), ont bien compris cela, et elles ne perdent pas une minute pour s’allier avec ces luttes plus larges qui se mènent au nom du conservatisme. Ce que ces femmes veulent, c’est que les choses restent comme elles sont. Et elles le disent clairement : les femmes trans* sèment la confusion dans ce que cela signifie qu’être une femme. Comme si “ce que cela signifie qu’être une femme” était une bonne chose et devait rester identique !
Ce qu’il nous faut affronter, c’est la structure toute entière qui fait qu’il est possible pour les transphobes de dire les choses horribles qu’ielles disent et que ces choses soient comprises comme si elles avaient du sens. Parce que bien sûr, nous on sait que ce qu’ielles disent est absurde, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui pensent que c’est du bon sens que d’insister sur la différence entre les femmes trans* et les femmes cis. Pour nous, ce n’est vraiment pas intéressant de faire cette différence, mais pour elleux oui. Alors comment est-ce qu’on change de paradigme et de régime de vérité, comment est-ce qu’on fait en sorte que le sens commun change, parce que ce sens commun, il coûte des vies ?
Et c’est ce que Fred n’arrête pas de répéter dans Les sous-communs mais aussi dans son propre travail, dans In The Break par exemple, où il s’interroge : comment est-ce qu’on en arrive à entendre le jazz comme du bruit ? Et sa réponse c’est : hé bien parce que nos oreilles ont été accordées aux sons de la musique classique blanche, où l’harmonie est élevée à un rang supérieur par rapport aux autres sons. Mais la musique c’est plein de choses, et l’harmonie n’est qu’une des multiples expressions de la musicalité. Fred a écrit par exemple sur la critique que Adorno a faite du jazz en montrant que c’est en réalité une critique à la musique noire, qui se trouve dépeinte comme primitive, ou bruyante.
Ce qui est intéressant là-dedans, c’est la manière dont on ne sait pas toujours qu’on est sous l’emprise d’un régime de sens commun. Si on prend un exemple de culture pop contemporaine, ce sera la même chose. On parle souvent du sexisme dans le hip-hop, notamment parce qu’il y a beaucoup d’insultes. Mais est-ce que c’est plus sexiste que le mec blanc sirupeux avec sa guitare et qui se lamente sur sa femme qui l’attend allongée sur son lit ? C’est tout aussi sexiste, mais parce que le hip-hop est entendu comme agressif, c’est sur lui qu’on tombe. Il y a pas besoin de dire bitch [salope] à tout bout de chanson pour être sexiste ! Simplement, quand c’est chanté sur les bonnes fréquences harmoniques, ça passe. On a besoin d’accorder nos oreilles à d’autres fréquences, voilà ce que je veux dire. Et là nous sommes dans une salle dédiée à Pauline Oliveros et à sa pratique de l’écoute profonde [1]] et c’est exactement ce qu’elle voulait dire. Est-ce que nous pouvons nous entraîner à entendre la transphobie et l’homophobie dans ce qu’elles ont d’“accordées” au sens commun, au raisonnable de ce que le capitalisme est en train de nous faire avaler, plutôt que de nous fixer sur des textes ou des actes qui certes sont plus visibles et vraiment horribles, mais qui ne sont pas le problème principal ? C’est le statu quo notre problème, et c’est le truc qui finit par ne jamais être remis en cause. Voilà ce qui me semble être le bénéfice de l’angle sous-commun : n’attaque pas juste les ennemis les plus bruyants ; sois attentifz aux signes du régime du sens commun auxquels tu n’es même pas conscienz de participer.
Fig Docher : Ma question serait : Pour qui est-ce qu’on écrit, et comment est-ce qu’on l’indique ? C’est une question qui me touche profondément personnellement, et qui, je pense, est peut-être partagée. Je pensais à ça dans la lecture du texte original mais aussi dans sa traduction. On peut discuter des moments où ça se passe mal, mais j’aimerais surtout parler des moments où ça se passe bien. Tu as peut-être des expériences d’avoir fait un effort d’intention, d’essayer de communiquer quelque chose, puis d’avoir eu un retour de cet écho… ?
Jack Halberstam : Tu peux voir, à la lecture de ces deux livres, que même si j’ai une certaine orientation théorique, je ne suis pas à proprement parler un expert en théorie de haut vol. Je taquine toujours Paul Preciado parce que sa pensée est massive (je l’ai déjà entendu faire des conférences de deux heures où il commençait son récit en 1492 et arrivait à tisser des conséquences de là jusqu’à la période contemporaine). Pour ma part, je crois être un penseur anti-monumentaliste. C’est comme ça que je le dirais. Je pense souvent, comme je viens de l’expliquer, en termes de petites choses. Pour moi, le grand récit, c’est terminé : ce n’est pas pour moi et je n’essaye pas d’en inventer de nouveaux. J’essaye de partir de quelque chose de spécifique duquel je peux dire quelque chose, et c’est ainsi que les choses commencent. Cela veut dire que je ne cherche pas à participer aux discours à un niveau théorique abstrait.
Il m’arrive notamment de parler debasse théorie, ce que je contraste notamment avec les théories qui nécessitent un très grand degré d’abstraction afin de dévoiler certaines manœuvres idéologiques, dont on n’aurait pas conscience autrement. Preciado fait cela admirablement. (Cela dit, je me corrige tout de suite, ce qui fait la qualité de Preciado, c’est justement qu’il s’efforce de faire des allers-retours haute et basse théorie ; et même Butler vient d’écrire un livre pour une maison d’édition non universitaire, pour essayer de s’adresser à un public plus large de manière accessible, donc ce n’est pas toujours vrai que ces deux-là ne pensent que de manière monumentale.)
En tous cas, pour ma part, je conçois toujours mon public presque comme si c’était des étudianxtes en licence. Et ce n’est pas une insulte : j’écris pour ces personnes parce que ce sont des personnes qui ne pensent pas déjà tout savoir, qui voudraient bien savoir pourquoi telle ou telle chose devrait les intéresser, et qui pourraient peut-être bénéficier d’une perspective autre que celles qui existent déjà. Or ces étudianz, qu’est-ce qu’iels font ? Iels lisent toutes sortes de textes, iels regardent des dessins animés ou des comédies, iels écoutent de la musique pop – toutes sortes de choses auxquelles la théorie ne porte pas forcément attention. Et mon but est souvent d’inclure autant de personnes que possible.
J’ai souvent commencé à écrire des livres avec l’intention d’être accessible, mais je ne crois pas y être parvenu, je ne crois pas avoir trouvé l’endroit idéal où tu es accessible et où tout le monde veut te lire. Parfois, il s’agit du style d’écriture, de ton sens de l’humour, de ton ingéniosité. Parfois, c’est accessible, mais ça n’atteint pas le public visé. J’ai une audience assez raisonnable au sein des universités, mais je ne suis jamais parvenu à en sortir. Donc je ne suis pas sûr, à dire vrai, d’avoir à écrire les livres accessibles que je voulais. Cela dit, les États-Unis ne sont pas la France. En France, il est possible d’avoir une culture publique et intellectuelle vibrante parce que les gens, en général, lisent. Aux États-Unis, en dehors de l’université, les gens ne lisent pas autant. Et cela implique que ce qui est accessible doit à un moment donné passer sur TikTok ou Twitter. Donc j’ai eu différents publics pour cible à différents moments.
Dans mon cas, le livre qui a vraiment le mieux marché, c’est probablement The Queer Art of Failure et c’est parce que tout le monde a pu faire l’expérience de l’échec. Tout le monde a vécu ça, et tout le monde en voudrait une compréhension, au-delà d’avoir l’impression d’être unxe loser, ou d’avoir merdé. Parce que si c’est humain, si échouer fait partie de l’expérience humaine, on devrait certainement pouvoir rendre compte de l’échec, et en rendre compte dans notre compréhension du soi. Et ce que j’ai montré dans ce livre, c’est que l’échec a beaucoup été relégué aux personnes queers, pauvres, raciséxes, ce qui a permis aux personnes blanches normatives de classe moyenne puissent se concevoir comme ayant atteint le succès.
Sous le régime capitaliste, réussir veut dire une chose : faire de l’argent. Faire de l’argent, est-ce que c’est vraiment ce qu’on a envie de dire ? Est-ce qu’on ne voudrait pas plutôt dire que réussir, c’est réussir à prendre soin de nos proches, réussir à créer de véritables communs dont nous puissions répondre ? En régime capitaliste, le succès n’est jamais redistribuable, il est toujours individuel, synonyme de capital (toi, tout‧e seul‧e, tu as gagné beaucoup d’argent). Ou alors, dans un contexte plus intime, le succès est défini comme avoir une famille avec des enfants. Tout le monde se fiche de savoir si tu es heureuxe, ou si tu es dans une bonne relation, ou si tu es bon‧ne envers tes enfants. On veut seulement savoir si tu es marriéxe et si tu as eu des gosses. Mon argument, c’est de dire que si tels sont nos modèles de succès, nous ferions mieux d’échouer. Ainsi l’échec a une capacité à rassembler tout à la fois une critique anti-capitaliste et une critique de la famille. L’échec permet de créer une communauté de losers, un commun, un commun des perdant‧es. Et dans ce commun loser, nous avons l’opportunité de créer d’autres choses dont on peut prendre soin en dehors des logiques qui ont véhiculé ce succès. Et je pense que ce message-là est passé, notamment parce que dans le livre, j’utilise la culture populaire à mon avantage. Mon archive, du début à la fin du livre, est constituée de films d’animation.
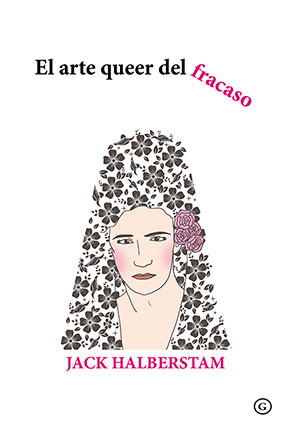
Cela dit, il y a aussi une série de chapitres très sérieux sur la manière dont, même dans les communautés queers, on a tendance à ne raconter que les histoires de succès, comme s’il ne fallait raconter que les histoires de sortie des ténèbres, et de naissance dans la lumière, bref, les histoires de mariage gay. Et là nous sommes en plein dedans : nous cherchons la reconnaissance de l’État sans toujours comprendre que ça nous rend complice de toutes sortes de mécanismes d’exclusion auxquels on pouvait autrefois s’opposer. En ayant été recrutées du côté du succès, nous voilà conduit‧es à être celleux qui s’inquiètent de l’immigration et qui veulent investir dans le marché immobilier, et ainsi de suite. C’est ainsi qu’à la fin du livre, j’affirme que l’histoire queer doit aussi être une histoire sombre. Il y a toujours eu des personnes queers impliquées dans des régimes que l’on répudierait. Je prends l’exemple du nazisme, qui a, à pleins de moments, été orchestré par des personnes que l’on reconnaîtrait aujourd’hui comme homosexuelles. Je raconte l’histoire de l’homosexualité sous les conditions du nazisme afin de dire qu’être gay ne fait pas de nous une bonne personne. Ce serait une conception ridicule des identités sexuelles et de genres. Être marginaliséxe ne fait pas de toi une personne anti-raciste, cela ne te donne pas automatiquement un sens de responsabilité vis-à-vis d’une conscience de classe, etc.
Bon tout cela pour dire que, de bien des manières, ce livre a vraiment dépassé mes attentes. Je ne pensais pas qu’il était cohérent, mais la cohérence n’est pas mon fort (je crois même que la plupart de mes livres sont un peu incohérents). En tous cas, je ne pensais pas que ce livre allait parler à une telle variété de publics. J’ai écrit d’autres livres que j’estimais en être plus capables, mais qui ne l’étaient finalement pas, donc bon. Il est sans doute utile, dans son propre travail, de penser à qui va être son audience, mais il est sans doute aussi bon de se rappeler qu’on ne peut pas le savoir en avance. Il se pourrait qu’un groupe de personnes dont on ignorait l’existence porte un réel intérêt pour la publication de tel ou tel travail, si l’on est capable de ne pas simplement positionner son travail au sein d’un unique ensemble de conversations.
Clovis Maillet : Je pense justement à la question de l’adresse. Dans l’écriture de certains de mes livres, je pensais davantage à qui je ne voulais pas m’adresser, avec qui je ne voulais pas m’associer. Parce que je suis un médiéviste, je voulais que mes livres soient explicitement non-conservateurs et le fait qu’ils atteignent d’autres personnes était une bonne surprise. Parce que quand tu dis que tu écris un livre pour quelqu’un·e, c’est un peu comme écrire une lettre d’amour, tu ne sais pas si ça va résonner chez l’autre…
Jack Halberstam : Et il se peut même qu’il soit reçu exactement de la manière dont tu l’as souhaité. Exactement. C’est ce qui nous fait écrire, cet échange d’idées, si dynamique et excitant, n’est-ce pas ? Tu ne sais pas à l’avance quel public pour quel livre ! Et si ce que tu communiques va être accueilli sans blesser ou créer un type de discours différent que tu n’avais pas anticipé et qui peut être compris comme conservateur ? Il y a des éléments de Trans* qui je pense, quand ils sont lus par des critiques issus des nouvelles générations, ne sont pas aussi bien reçus aujourd’hui. Parce que la jeunesse trans est précisément le sujet de ces passages. Alors, il se pourrait qu’ils ne réagissent pas très bien. Mais au moment où j’ai écrit ce livre, les combats intergénérationnels étaient ridicules et avaient besoin d’être envisagés de front. Alors j’espère fort que cela donnera une information sur les premières décennies du XXIème siècle et sur la manière dont trans* a évolué d’abord autour de ces combats intestinaux et ensuite, à cause de l’expansion d’un capitalisme autoritaire portant son attention sur les positions critiques du genre et anti-genre, la jeunesse trans a été placée sous une certaine surveillance. Dans ces conditions, tout ce que je peux dire pour ma défense c’est que nous aurions dû avoir un but plus large dès le début. C’est ce que j’essayais de dire à l’époque. Nous n’aurions pas dû nous quereller les unes avec les autres. Nous ne devrions pas nous disputer aujourd’hui. Nous devrions avoir le but commun d’attaquer ces mouvements “critiques du genre” et leur soutien venant des régimes autoritaires qui nous gouvernent aujourd’hui, que nous le sachions ou non. En France, je sais que Macron sera probablement remplacé par quelque chose de pire. Et qu’en Allemagne, le parti d’extrême droite a beaucoup d’influence. Et aux États-Unis, Trump se porte de nouveau candidat. Au Brésil, sans doute Bolsonaro ou quelque autre bolsonariste vont revenir. Et l’Argentine a maintenant un gouvernement de droite. Et dans ces circonstances, et dans ce monde, avec toutes les questions écologiques qui nous inquiètent, nous ne pouvons pas nous battre les un·es avec les autres. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et donc la question d’Emma sur les communs est très importante, et je crois que ce que je voulais c’est mettre au repos quelques sujets sur lesquels on se battait pour dire : des genz se sont battuz durement pendant trente ans pour faire ce qu’iels avaient besoin de faire sans tout le soutien disponible aujourd’hui. Or, avec le soutien et la visibilité, vient l’attention, et ce n’est pas toujours une bonne chose. Vous savez, il n’y avait pas le même genre de ciblage des personnes trans dans les années 1970 et 1980 simplement parce qu’il n’y avait pas de conversation sur les personnes trans dans ces années-là. On ne savait même pas comment trouver quelqu’un·e pour se faire prescrire des hormones ou aucune de ces choses. C’était un moment différent. Mais avec la visibilité et la demande de reconnaissance vient le ciblage, parce que vous demandez à l’État quelque chose et l’État a maintenant la capacité d’utiliser cette information qu’il a accumulé sur vous en tant que communauté pour trouver un moyen de vous exclure, de vous punir, de vous nuire et plus encore.
Clovis Maillet : Peut-être que c’est une question liée : quelles seraient tes stratégies ou tes idées pour s’en sortir avec l’idée de visibilité sans retourner au placard ?
Jack Halberstam : Pour moi, la réponse est ici comme ailleurs : il nous faut renforcer nos combats communs. Les combats communs demandent de la solidarité entre des groupes qui ne se comprennent pas bien qu’ils soient impliqués dans le même combat. Nous sommes dans un monde où nous pouvons utiliser les technologies virtuelles pour nous réunir, et nous ne le faisons pas. Nous les utilisons pour regarder des vidéos de chats et pour avoir ces mêmes débats, tu sais, des débats adjacents plutôt que des débats qui font avancer. Alors, ma stratégie est de toujours mettre la solidarité avant les intérêts. Et ce que je disais plus tôt dans l’entretien avec la personne du Monde : ce n’est pas une utopie. C’est exactement ce qu’il se passe en Amérique Latine, à la fois au Chili, en Argentine et au Brésil, des genz se sont uniz avec solidarité dans des groupes qui se rassemblent autour des femmes trans. Le transféminisme en Argentine est un mouvement massif géré par des femmes trans, des féministes socialistes et des personnes en dehors de l’économie formelle. Et iels ont été très efficaces. Donc ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas d’exemples. Il y en a. C’est juste que nous avons un peu des œillères. Nous continuons de légiférer sur les mêmes points, encore et encore. Je pense que c’est pour cela que Paul B. Preciado, Veronica Gago, Judith Butler sont des personnes qui essaient depuis quelques temps d’articuler la lutte pour et à travers les communs des personnes queer et trans, aux côté et en solidarité avec les luttes anti-racistes et les luttes de classes, comme le Mouvement des Travailleureuses Rurales Sans Terre au Brésil (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Les études trans ne devraient pas se réduire aux terfs. La quantité de textes produits sur les terfs donne l’impression que ce groupe de femmes qui est peut-être une centaine dirigent en réalité le monde. Elles ne dirigent pas le monde ! Elles sont stupides, et elles font partie d’un régime conservateur. Et pendant tout le temps qu’on passe à parler d’elles, il ne reste plus de démocraties, et on ne voit plus d’alternative au capitalisme. Et ce qui m’inquiète. Est-ce qu’on peut sortir de ces bourbiers ?
Emma Bigé : Ce que tu dis me fait penser à unevidéo que XY Media a publiée il y a peut-être deux jours à propos des pénuries de testostérone en France et ailleurs, où il était assez clairement expliqué comment ces pénuries étaient connectées à l’exploitation des travailleureuses du complexe médico-industriel et des grandes entreprises pharmaceutiques qui forcent leurs employé‧es à travailler à flux tendu. Ca m’a frappé parce que je me suis dit : voilà une belle manière de dire “je n’ai pas besoin de ton aide ; j’ai juste besoin que tu comprennes que cette merde te tue toi aussi, bien que plus doucement” ; voilà une manière puissante de construire une alliance trans*catégorielle.
Bon je pointe ça d’abord pour faire écho à ce que tu dis (à savoir : les coalitions trans* existent déjà, et nous avons besoin de les renommer), mais surtout parce qu’on avait une question, Clovis et moi, qu’on voulait te poser sur une coalition trans* spécifique, à savoir celle qu’on pourrait appeler les écologies trans* ou les écotransféminismes. Est-ce que tu saurais décrire des points où cette coalition s’est produite, ou aurait des chances de se produire dans un futur proche ? Une manière pour trans* d’être un appel aux armes contre le capitalisme extractiviste ou comme une clef de lecture pour la crise climatique, un peu à la manière dont tu viens de décrire que le transféminisme avait fonctionné comme un appel aux armes pour la gauche radicale en Argentine ?
Jack Halberstam : C’est intéressant, je sors tout juste d’un événement à New York où il y avait deux personnes qui pensaient justement ces questions : l’une était Heather Davis, une chercheuse à la New School qui a écrit ce livre, Plastic Matter, qui est un livre remarquable où elle propose un point de vue queer et trans sur la crise écologique ; et l’autre était cette biologiste, Malin Ah-King, qui a notamment écrit un article avec Eva Hayward sur les “sexes toxiques”. Et elles parlaient toutes les deux de la manière dont certains groupes écologistes sont aux prises avec des formes de panique autour du genre, en particulier en ce qui concerne la pollution au plastique et la manière dont elle affecte la fonctionnalité reproductive. Du genre : les “femmes” ont du mal à tomber enceintes et les “hommes” ont moins de spermatozoïdes. Et cette situation crée une réponse du type : “oh mon Dieu, on attaque l’ordre du genre ; vite, vite, mettons en place une politique de la pureté, nous avons besoin de nettoyer l’environnement pour redevenir des hommes et des femmes.” Et c’est ainsi que les paniques à l’égard des personnes trans et les questions environnementales se trouvent liées.
Et donc, en nous efforçant de nous inscrire dans la filiation de l’épistémologie féministe de Donna Haraway et de Karen Barad notamment, nous étions là à essayer d’articuler une écologie queer et trans qui ne reposerait pas sur un investissement envers les politiques de la pureté, mais qui reconnaîtrait que nous vivons dans un monde décidément sale. Autrement dit, comment nous engager à 100% dans l’idée de rendre le monde plus propre au sens de “moins polluant”, sans pour autant nous investir dans la peur de l’impureté et des mutations du genre, de la fertilité et des formes de reproduction ? Et Malin Ah-King insistait bien : nous n’arriverons pas à nous débarrasser entièrement de la pollution et des mutations qu’elle a provoquées ; le plastique ne disparaîtra pas. C’est une des choses que nous apprennent les études queer et trans : le chemin de la pureté et de la restauration complète est illusoire ; ce dont nous avons besoin, c’est de pratiques pour apprendre à vivre dans la crasse, dans la merde, dans les ordures, dans le compost, au milieu de la consommation et de la production.
D’un autre côté, un bénéfice des études queer et trans, ce peut aussi être d’apprendre à voir comment la famille hétéronormative est une institution particulièrement polluante, et comment des institutions qui n’ont pas l’air d’être liées à l’écologie le sont en fait profondément. Donc bien sûr, les entreprises, et les cadeaux fiscaux qui leur permettent de continuer à fonctionner alors qu’elles polluent continuellement les eaux que nous buvons, sont un problème majeur de la lutte environnementale. Mais les études queers et trans, tout en disant cela, nous rappellent qu’il ne faut pas perdre de vue la manière dont nous faisons cette critique, et comment les critiques environnementalistes peuvent rejouer, à un autre niveau, le problème contre lequel elles luttent. Malin Ah-King donnait l’exemple d’une campagne en Suède qui s’inquiétait des faibles taux de spermatozoïdes et qui avait pour slogan : “sauvez l’homme”, pas “sauvez les baleines”, mais “sauvez l’homme”, “le mâle est en danger”. Et il faut penser que c’est l’État qui a lancé cette campagne, et qu’elle parle à beaucoup de gens, qui se retrouvent à s’inquiéter des spermatozoïdes de leurs enfants, ou de leurs maris. Voilà jusqu’où l’hétéronormativité vient s’intriquer.
Et c’est ce langage de l’intrication (Karen Barad) ou du trouble (Donna Haraway) dont nous avons besoin, pour nous dire : nous y sommes et nous ne pouvons pas nous en sortir si facilement ; il y a certains flux qui sont lancés pour de bon et ce dont nous avons besoin c’est d’apprendre à vivre avec eux plutôt que de chercher à les éradiquer pour essayer désespérément de revenir à une pureté intenable. Il nous faut des solutions contre-intuitives.
Et je pense à Max Liboiron, un‧e écologiste Première Nation qui vit au Canada qui a notamment écrit Pollution is Colonialism, où iel défend l’idée que si l’on veut parler de pollution, il faut d’abord que l’on parle politique terrienne et colonialisme. Il y a pollution parce qu’il y a accaparement des terres. L’accaparement des terres par les colons, c’est cela le début de l’Anthropocène : pas la machine à vapeur, pas l’usine, mais l’accaparement des terres et des sous-sols, dans lesquels aujourd’hui encore l’extractivisme vient puiser ses ressources. Et sa position est une position trans écologique autochtone qui s’efforce de nous rappeler qu’avant le colonialisme, il y avait des peuples autochtones qui cultivaient la terre sans la défigurer, et il le fait vraiment depuis une position qui n’est pas de fantasme de retour à un statu quo ante, mais plutôt une manière de rappeler que ces peuples sont toujours là, et qu’ils continuent à veiller sur leur territoire, et qu’on aurait beaucoup de choses à apprendre d’eux.
Et enfin, il y a l’œuvre de Barad, et en particulier son article sur les trans*matérialités. Je suis très attaché à la manière dont iel travaille avec la mécanique quantique et la théorie quantique des champs, que les personnes qui travaillent dans les humanités utilisent rarement parce que, soit disant, on n’y comprend pas grand’chose. Mais je lisais justement un livre sur la physique quantique qui disait : les physicien‧nes non plus n’y comprennent pas grand’chose ; c’est-à-dire que la physique quantique excède tellement la capacité humaine de savoir, d’imaginer, de conceptualiser, que les scientifiques ont beau utiliser des équations, tout ce qu’iels arrivent à toucher ce sont les ombres des idées qu’iels essayent de décrire, au bord de leurs propres capacités de comprendre. Et je crois que nous avons besoin de faire cela davantage.
Donc on est un peu passé de “il faut parler à tout le monde et être accessible” à “nous avons besoin de nous pousser au bord de ce que nous sommes capables de comprendre”. Mais parce qu’il n’y a que cela pour produire de nouveaux savoirs, non ? Parce que si on le comprend à peine, si ce n’est pas déjà disponible, alors c’est le genre de matières avec lesquelles nous avons besoin d’être en dialogue.
traduit de l’anglais par emma b., Fig,
léo love et matthias et paulus
Image de couverture : ’Still de la vidéo Unresolved Image, Neige Sanchez et Fig Docher, 2023’
[1] [NdT : cette conversation a eu lieu dans les murs del’exposition Un-Tuning Together : Pratiquer l’écoute avec Pauline Oliveros